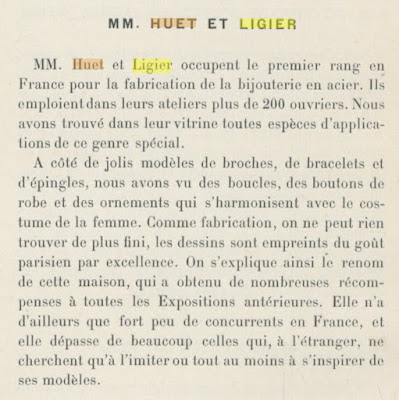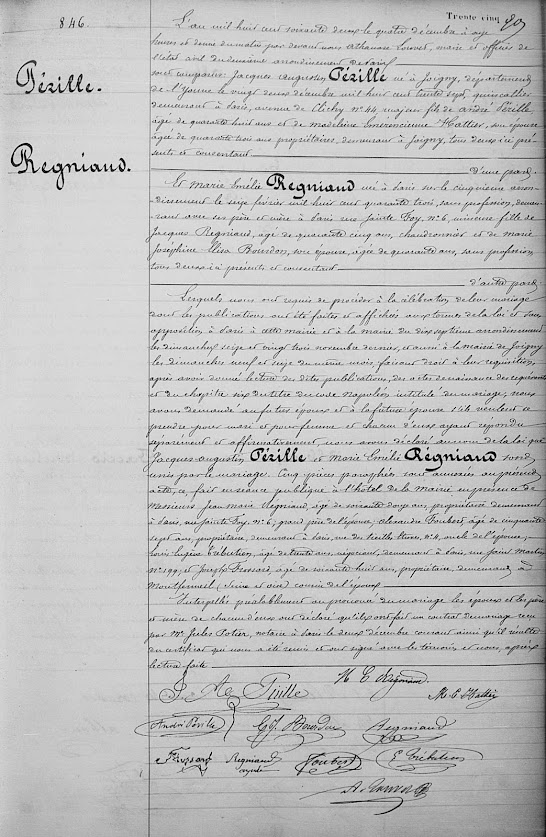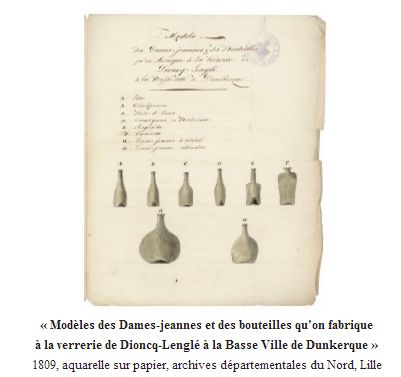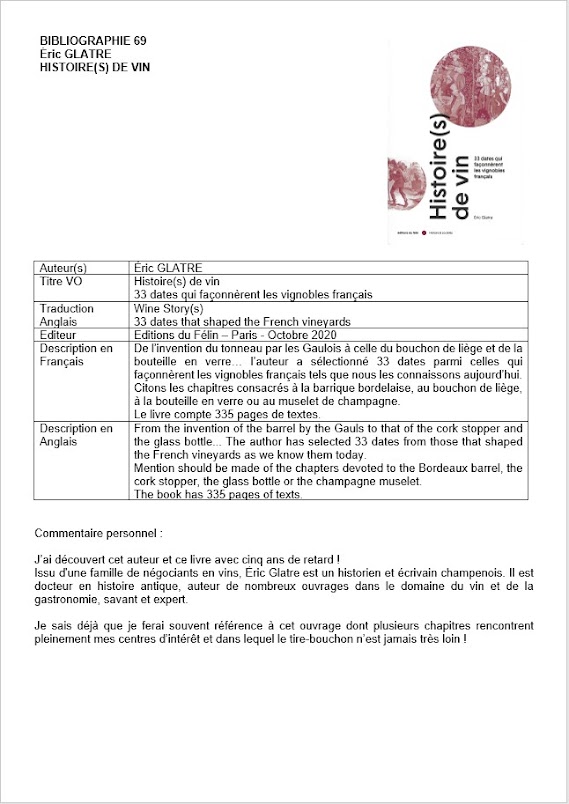Amis blogueurs, bonjour !
Nous nous étions arrêtés dans mon dernier article à l'association Huet & Ligier et à l'arrêt de leur usine de Coye-la-Forêt en 1914.
Voici la suite de l'histoire qui conduit de
COYE-LA-FORET à CHAUMONTEL, et de
HUET & LIGIER à CANUET
et ses tire-bouchons énigmatiques
Dès avant 1900, des relations se développent entre Louis Léon Huet et Emile Paul Félix Ligier d’une part, et un concurrent voisin et de même génération, Albert Victor
Benjamin Canuet (1860-1916) d’autre part. Tous trois sont fabricants de "bijoux en acier" et sont primés dans des expositions, comme à Anvers en 1894 ou Paris en 1900.
Canuet (1860-1916) est le gendre et héritier de l’industriel Charles Eugène Espiridion Goupil (1831-1895), lui-même successeur de la Maison N. Marguerie, fabricant de perles métalliques (roulements à billes notamment). La fabrique Goupil - Canuet est installée dans la ville de Chaumontel (Seine-et-Oise, aujourd’hui Val d’Oise), proche de Coye-la-Forêt (Oise), avec magasin de vente et siège social au 68 rue de Bondy à Paris.
Les deux usines sont situées dans deux départements différents donc, mais cinq kilomètres seulement les séparent.
A 5 km les uns des autres...
L’épouse d’Albert Victor Benjamin Canuet, Marie « Jeanne »
Goupil, lui donne trois fils : Victor Albert « Maurice » Canuet
(1886-1956), puis des jumeaux « André » Eugène Canuet (1888-1897),
décédé enfant, et « Marcel » Fernand Canuet (1888-1978).
Dès 1914, les
deux enfants survivants sont associés par leur père à la direction de
l’entreprise, dont la raison sociale devient A. Canuet & Fils.
Après le décès d’Albert Victor Benjamin Canuet en 1916, les
relations qui se sont développées entre Louis Huet et Emile Ligier et le fils ainé, Maurice Canuet, aboutiront à une association
dirigée par ce dernier, puis à la création d’une société
en nom collectif Louis Huet, Emile Ligier et Maurice
Canuet.
Après la fin de la première guerre mondiale, la société en
nom collectif dirigée par Maurice Canuet transfère les outils de production de
Coye vers l’usine de Chaumontel. L’usine de Coye-la-Forêt est détruite et les
terrains vendus aux Lescuyer de Savignies, propriétaires du Château.
-/-
Brevet pour un tire-bouchon
30 avril 1922 : Victor Albert « Maurice » Canuet,
obtient, sous le nom de Victor Le Canuet, le brevet n° 540.601 pour un
« tire-bouchon formant en même temps débouchoir de bouchages métalliques ».
|
|
|
|
|
Dessin du Brevet
n° 540.601 du 30 avril 1922 |
Variante avec décapsuleur et un coupe-muselet
(Collection personnelle) |
Variante avec décapsuleur et deux coupe-muselet |
Pourquoi cet usage de prénoms différents et du nom de « Le »
Canuet ? nous l’ignorons ! Mais les tire-bouchons Le Canuet sont aujourd’hui
recherchés.
Nous devinons seulement qu'à l'instar de son beau-père Charles Eugène Espiridion Goupil, Victor Albert «
Maurice » Canuet est une personnalité hors du commun à Chaumontel, ville dont il sera élu
maire en 1925.
-/-
Canuet Frères
Le 31 décembre 1922 : la société
en nom collectif Louis
Huet, Emile Ligier et Maurice Canuet
est dissoute par le même Victor Albert « Maurice » Canuet.
Le fonds est cédé à la Société en nom collectif Canuet Frères, composée
des seuls deux frères, Victor Albert « Maurice » Canuet (1886-1956) et « Marcel »
Fernand Canuet (1888-1978). Le siège parisien est transféré du 68 rue de Bondy Paris 10° au 118 rue de Turenne Paris 3°.
31 décembre 1922 : dissolution de la société en nom collectif
Louis Huet, Emile Ligier et Maurice Canuet
((Journal L’Usine – Gallica)
Cette société est ensuite transformée en SARL Canuet
Frères en 1927.
En 1928, la SARL Canuet Frères publie des encarts
publicitaires dans l'annuaire du commerce Didot – Bottin. Elle communique aussi sur sa marque de
fabrique, reprise de celle déposée par Huet & Ligier en1895 : des anneaux de clés.
Annuaire du commerce Didot-Bottin 01011928 | Marque de fabrique Annuaire du commerce Didot-Bottin 01011928 |
On peut voir sur cette publicité de 1928 que les tire-bouchons ne sont plus listés
dans les fabrications.
Pour les années qui suivent, les renseignements nous manquent.
Nous savons seulement que la SARL Canuet Frères est encore active au début de l'occupation allemande, comme le montre un courrier adressé le 16 août 1940 en réponse à une enquête du Préfet de Seine-et-Oise à Versailles :
Nous savons seulement que la SARL Canuet Frères est encore active au début de l'occupation allemande, comme le montre un courrier adressé le 16 août 1940 en réponse à une enquête du Préfet de Seine-et-Oise à Versailles :
https://archives.valdoise.fr/
-/-
Au-delà de la seconde guerre mondiale, nous n'avons pas retrouvé d'éléments sur la fin de cette entreprise chaumontelloise, si ce n'est que l'usine désaffectée avait fait l'objet d'un projet immobilier.
Peut-être pourrez-vous nous apporter de nouveaux éléments ? Je ne manquerai pas de les publier !
M