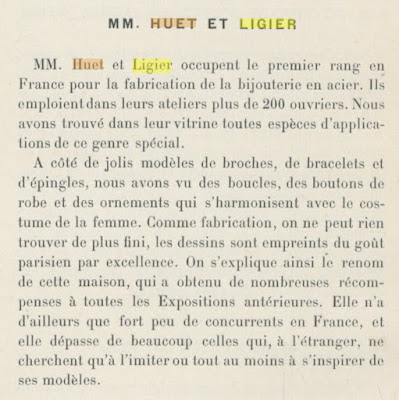Amis blogueurs, bonsoir !
Voici ma modeste contribution en faveur d'un sursaut de la natalité.
Je vous propose pour cela une nouvelle énigme :
Enigma n° 85 : Quelques tire-bouchons figuratifs types Gagnepain ou Delaporte... consacrés aux bébés !
J'aime beaucoup les tire-bouchons à poignée de bronze et, parmi eux, plus encore les figuratifs.
Les poignées moulées sont souvent d'une grande précision et livrent ainsi des représentations détaillées des usages du temps.
Quels étaient les pères de ces poupons ou bébés ?
Le premier constat que l'on peut faire en examinant ces trois tire-bouchons est que les enfants représentés sont très emmaillotés et ont une tête d'adulte !
-/-
Des adultes miniatures
Nos tire-bouchons datent certainement de la seconde moitié du XIXe siècle et témoignent à leur manière de la façon dont étaient gérés les bébés.
Bébé est d'ailleurs une "invention" tardive en français :
Marie-France More! dans son livre Le bébé dans la France ancienne (XVIe-XIXe siècle) note ainsi :
"Avant la deuxième moitié du XIXe siècle, pour désigner le bébé, le français a recours à des termes très variés, plus ou moins tendres et plus ou moins précis : nouveau-né, nourrisson, enfant à la mamelle, enfant au maillot, poupard, poupon, enfant du premier âge ou en bas âge.
Quant à ce qu'il soit reconnu comme une personne, on est loin du compte. Avant sa naissance, le bébé n'existe guère ; il est seulement une possibilité de vie, sans sexe déterminé, dont seule la mère sent les mouvements."
Ajoutons que jusqu'à cette époque du XIXe siècle, la peinture représente l'enfant Jésus, ce symbole, comme un adulte :
Les vêtements portés ne sont de toute évidence pas ceux d'un petit enfant.
-/-
"ainsi entravé, le bébé est facile à garder pour peu qu’il soit accroché à un clou, [...] ou encore suspendu dans un sac"
Au XIXe siècle, les enfants étaient emmaillotés avant d'être habillés avec des vêtements copiés sur ceux des adultes en miniature.
Selon Wikipédia, "l’emmaillotement est garant de chaleur, de protection, et assure une pression rassurante pour le bébé. Il a d’autres fins : ainsi entravé, le bébé est facile à garder pour peu qu’il soit accroché à un clou, comme cela se pratiquait dans certaines régions du Poitou, ou encore suspendu dans un sac au Pays basque."
Les deux premiers tire-bouchons, de même facture, montrent des enfants emmaillotés, avec bonnet et foulard noué dans le dos.
Le troisième tire-bouchon montre avec précision le bonnet de baptême et les bandes croisées sur la chemise de l'enfant, lui interdisant tout mouvement des jambes.
-/-
Les fabricants
Les deux premiers poupons sont de type Gagnepain, cependant les mèches ne sont pas à section carrée et ils ne sont pas marqués :
Petit modèle (hauteur 5 cm), mèche tranchante
Grand modèle (hauteur 6,5 cm), mèche ronde
Dans son livre Les Tire-Bouchons Figuratifs, Simon Znaty présente un autre exemplaire ainsi qu'une percette, manifestement issus d'une matrice similaire. Le tire-bouchon a une autre mèche, au fût très travaillé.
Collection Simon Znaty
Qu'en déduire, sinon que des mèches très différentes ont été montées sur les mêmes poignées issues de fonderie ?
Qui les fondait ? C'est toute la question !
Les mèches montées par Gagnepain (actif de 1871 à 1895) et ses premiers successeurs, Bauer (1895-1905) et Burgun (1906-1914), étaient habituellement de section carrée.
Après eux Haillus (1915-1941), puis Magot & Castella (1941-1960), monteront plutôt des mèches rondes.
Les marquages ont été tantôt repris (le marquage Gagnepain surtout), tantôt abandonnés, selon les époques.
Ajoutons que Gagnepain et ses successeurs ne sont pas les seuls à avoir proposé des poignées moulées : Guinot, Langlois, ou les Delaporte ont fait de même.
La poignée de notre troisième tire-bouchon est très différente et sa mèche semble bien sortir de chez Delaporte, comme peut-être aussi celle du tire-bouchon de Simon :
-/-
Alors quel âge ont nos poupons ? Et qui sont leurs géniteurs ?
Pour une fois, "c'est bien l'habit qui fait le moine" : l'emmaillotage de ces bébés serait très anachronique au XXe siècle, comme probablement aussi l'utilisation d'enfants en bas âge pour servir de tire-bouchons...
Les moules qui ont servi à couler ces modèles ne peuvent dater au plus tard que de la deuxième moitié du XIXe siècle, même si les stocks de poignées moulées ont pu continuer à être utilisés pendant quelques décennies.
-/-
J'espère que vos contributions permettront d'identifier ou au moins de nous rapprocher du ou des pères sinon de nos bébés, du moins de nos poignées moulées.
Je serais heureux aussi de recevoir vos photos d'autres tire-bouchons de la même famille et d'ainsi élargir cette fratrie et je manquerai pas de les publier.
M